Le feu couve
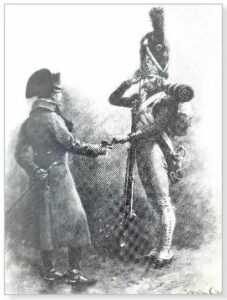 Les lampions des festivités en cette fin d’année 1807 surréaliste à la fois d’exubérance et de prestige viennent de s’éteindre. En ce tout début 1808, l’ambiance est morose. Dans les casernes de la Garde, on bougonne car le paiement de la solde atteint un retard allant jusqu’à 6 mois pour les chasseurs à cheval. Les artilleurs cantonnés à la Fère (Aisne) jalousent les cavaliers et les fantassins tout près de l’Empereur à Paris. Le bataillon des marins sur le chemin du retour pendant les festivités n’arrivera à Paris que le 14 janvier dans un piteux état. Dans la capitale, la vie est monotone et on rompt l’ennui en spéculant sur une prochaine reprise du sac à dos. En effet, un feu couve dans la péninsule ibérique depuis l’été 1807. Le blocus continental que Napoléon vient d’instaurer pour isoler l’Angleterre et paralyser ses échanges laisse apparaître des failles au Portugal, bientôt sommé de fermer ses ports au commerce britannique. L’occupation du Portugal à l’automne 1807, après une rapide conquête par le corps expéditionnaire du général Junot, donne l’impression à l’Empereur qu’une domination française sur le reste de la péninsule est acquise, convaincu de la faiblesse de la monarchie espagnole à la tête d’un pays en proie à une grave crise politique.
Les lampions des festivités en cette fin d’année 1807 surréaliste à la fois d’exubérance et de prestige viennent de s’éteindre. En ce tout début 1808, l’ambiance est morose. Dans les casernes de la Garde, on bougonne car le paiement de la solde atteint un retard allant jusqu’à 6 mois pour les chasseurs à cheval. Les artilleurs cantonnés à la Fère (Aisne) jalousent les cavaliers et les fantassins tout près de l’Empereur à Paris. Le bataillon des marins sur le chemin du retour pendant les festivités n’arrivera à Paris que le 14 janvier dans un piteux état. Dans la capitale, la vie est monotone et on rompt l’ennui en spéculant sur une prochaine reprise du sac à dos. En effet, un feu couve dans la péninsule ibérique depuis l’été 1807. Le blocus continental que Napoléon vient d’instaurer pour isoler l’Angleterre et paralyser ses échanges laisse apparaître des failles au Portugal, bientôt sommé de fermer ses ports au commerce britannique. L’occupation du Portugal à l’automne 1807, après une rapide conquête par le corps expéditionnaire du général Junot, donne l’impression à l’Empereur qu’une domination française sur le reste de la péninsule est acquise, convaincu de la faiblesse de la monarchie espagnole à la tête d’un pays en proie à une grave crise politique.
La crise
Napoléon en profite pour renforcer les forces françaises dans la péninsule. Après une mise en alerte des troupes le 25 janvier 1808 et de rapides préparatifs au départ, 2 nouveaux corps d’armée et 2 nouvelles divisions formés par des instructeurs de la Garde font mouvement vers Bayonne pour se regrouper. Un régiment polonais aux ordres du colonel Krasinski les rejoint. Puis, c’est la bascule en Espagne, en échelons successifs, avec la traversée de la ville de Vitoria (pays basque espagnol) le 10 mars et Burgos (nord de l’Espagne, à 250 km de Bayonne) où ils sont accueillis par Murat.
Mais les évènements se précipitent et la situation s’enflamme : le 18 mars 1808, une révolte éclate à Aranjuez (50 km au sud de Madrid) et le roi d’Espagne Charles IV abdique en faveur de son fils Ferdinand. Le 23 mars, Murat entre à la hâte dans Madrid avec 30 000 hommes, escorté par la cavalerie de la Garde, alors que Bessières court vers Burgos pour prendre le commandement du détachement de la Garde impériale à pied restée sur place. Parti de Saint Cloud le 3 avril, l’Empereur n’attend pas son arrivée en Espagne pour ordonner la projection immédiate de la Garde au complet à Madrid. Cependant, il surprend par l’imprécision des ordres alors que le mois d’avril voit l’incertitude basculer dans la tragédie. Le feu est mis aux poudres par l’entrevue de Bayonne au cours de laquelle Napoléon force le retrait des Bourbons d’Espagne et la mise en place de son frère Joseph sur le trône madrilène.
L’embrasement
Le 2 mai, le peuple de Madrid s’insurge contre les Français avec une férocité inouïe et une détermination imprévisible. Le bataillon de fusiliers et les chevau-légers chargent une foule déchaînée et prête à tous les sacrifices. Pris à partie par des jets de pierres et des tirs meurtriers, les mamelouks de Murat répliquent en sabrant impitoyablement, y compris des femmes qui assaillent les cavaliers en les mordant jusqu’au sang après les avoir désarçonnés. Les têtes volent, tranchées par les cimeterres (sabre oriental à lame courbée). La terrible répression dure une semaine.
La guerre s’installe. L’insurrection s’étend à toute une Espagne en feu avec des foyers qui se développent sur tout le territoire. La réduction du plus virulent en Andalousie est confiée au général Pierre Antoine Dupont (ou « Dupont de l’Etang »). La Garde aux abois tente de maîtriser une situation devenue incontrôlable en violence et en soudaineté. Tous les officiers de mamelouks engagés à Madrid le 2 mai ont été tués. Des scènes d’une cruauté insoutenable sèment l’effroi dans la troupe déstabilisée. Le 1er juin, le bataillon des marins de la Garde sous le commandement du capitaine de vaisseau Daugier arrive en renfort de Dupont en proie aux pires horreurs dans une Andalousie hors de contrôle. Tout soldat rentrant dans une maison dans une rue étroite n’en ressort ni vivant, ni entier. Alors, sous l’épouvante, on tue femmes et enfants, on pille. Le sang éclabousse les murs d’un blanc immaculé de ces maisons d’Espagne écrasées par le soleil.
Fin juin, l’armée française réunit plus de 100 000 hommes, surtout des conscrits peu aguerris. Le 14 juillet 1808, Bessières, à la tête de la cavalerie de la Garde, bat les forces espagnoles du général de la Cuesta à la Médina de Rioseco (ville en province de Valladolid, 200 km nord-est de Madrid) et ouvre la route de Madrid à Joseph. Mais c’est un succès de courte durée car il devra évacuer la ville 10 jours plus tard, suite à la capitulation, le 22 juillet, du général Dupont pris au piège de Baylen en Andalousie.
Le désastre de Baylen
Alors que la plus grande partie de l’Espagne est en révolte ouverte, le général Dupont, avec 3 divisions dont une de cavalerie, est envoyé à Cadix pour rompre l’encerclement de ce qui reste de la flotte de l’amiral François de Rosily bloqués par des vaisseaux britanniques et espagnols, et ramener le calme dans la région.
Le 24 mai, le corps d’armée quitte Tolède avec 12 000 hommes dont 400 du bataillon des marins de la Garde. Le 7 juin, il bat un détachement espagnol composé de volontaires au pont d’Alcolea, (10 km de la ville de Cordoue). Le même jour, les Français prennent Cordoue et mettent la ville à sac pendant 4 jours, suscitant dans toute l’Andalousie, une soif de vengeance.
Le 14 juin, l’amiral de Rosily s’étant rendu aux Espagnols, Dupont quitte Cordoue le 16 et rétrograde vers Andujar (Andalousie, 300 km sud de Madrid), où il établit son camp de base. Isolé et harcelé dans une province hostile et en état de soulèvement, Dupont envoie plusieurs appels à l’aide à Madrid. Le 19 juin, un détachement de renfort de 450 cavaliers, 5000 fantassins et 10 canons quitte Tolède. Le 26 juin, il vient à bout de 2000 guérilleros dans la Sierra Morena (Andalousie). Il laisse un bataillon pour défendre le défilé, et rejoint avec le reste de ses forces le gros de son armée qui elle aussi est dispersée afin de contrôler la plus grande zone possible et de sécuriser les endroits stratégiques.
Côté espagnol, le général Castaños rassemble une armée de près de 31 000 hommes (4 divisions, dont une de montagne). Le 16 juillet, une bataille importante s’engage à Mengíbar, sur les rives du fleuve Guadalquivir (Andalousie). Bousculés, les Français font retraite en direction de Baylen (350 km sud de Madrid) dans une grande confusion dans la localisation des détachements dangereusement dispersés.
Le soir du 18 juillet, profitant de l’obscurité, Dupont quitte Andújar menacé pour échapper aux troupes de Castaños, établies à proximité. Le 19, en pleine nuit, l’avant-garde française est au contact d’un détachement espagnol, à 5 km de Baylen. Les combats commencent à 4 heures du matin, au moment où Dupont a rejoint la tête de la colonne. Il lance plusieurs assauts successifs au prix de lourdes pertes et une débandade d’hommes accablés par la chaleur intense et la soif. Voyant la situation désespérée, Dupont, avec seulement 2000 hommes valides, se décide à demander une suspension des combats. Les élongations entre les détachements sont telles que tout renfort éventuel est voué à l’échec alors qu’ils sont interceptés par les troupes de Castaños. Dupont est pris au piège dans une souricière. Le lendemain, les négociations conduisent à la reddition française.
La résistance des marins de la Garde, avec la perte d’un tiers de ses effectifs, n’aura pas suffi à empêcher l’encerclement des troupes du Dupont. La convention d’Aranjuez étant signée, les soldats pris par l’ennemi seront considérés comme prisonniers de guerre, mais les espagnols viennent de remporter une victoire décisive et qu’il s’agit du premier échec important des armées napoléoniennes
La tentative de maîtrise du conflit
Averti le 1er août de la capitulation de Baylen, Napoléon rentre dans une fureur emprunte de regret d’avoir laissé 15 000 hommes, dont un élément de la Garde, s’aventurer dans cette région désolée d’Espagne vers un tragique destin. Paradoxalement, animé d’un sentiment de toute puissance suite à la nouvelle donne géopolitique depuis l’été 1807, il s’enferre dans son projet hispanique, ce que l’historien et académicien Jacques Bainville qualifiera d’«enivrement de Tilsit» (cf. section 3), alors que la confiance des troupes est ébranlée et que de graves fissures dans le mythe de l’invincibilité de la Grande Armée éveillent les espoirs d’une Autriche engageant un réarmement et manifestant d’indéniables intentions guerrières (cf. section 5).
Mais au mois de mai 1808, l’Empereur est confiant : en intimidant l’Autriche provocante, on se donne du temps pour le règlement de l’affaire espagnole, pour lequel la Garde doit y prendre une place prépondérante. Aussi, l’effort est-il orienté sur une rénovation en urgence du matériel et de l’intendance (ambulances, chirurgiens, moyens de transport, boulangers, etc.). Le bataillon du train (appellation de « l’arme de la logistique ») en charge de l’acheminement du matériel est porté à 800 voitures et 1200 chevaux. Les unités de contact de la Garde incorporent dans ses rangs les soldats de la Ligne qui ont servi aux côtés de la Garde impériale depuis le début du conflit en Espagne.
Simultanément, l’organisation, confiée au général Walther alors commandant des grenadiers à cheval de la Garde stationnée à Paris, évolue sensiblement : le nombre d’unités augmente, mais leurs effectifs diminuent. De leurs côtés, les mamelouks incorporent des jeunes de 16 ans révolus venus avec les réfugiés égyptiens de Marseille. Le temps presse : l’Angleterre ne se contente pas de financer les armées continentales et de bloquer les ports européens. En effet, dès août 1808, un détachement de 12 000 hommes commandé par Sir Arthur Wellesley (le futur duc de Wellington) débarque au Portugal, bouscule l’armée du général Junot et le bat le 21 août à Vimeiro (Portugal, 70 km nord de Lisbonne), le contraignant à un repli dans la capitale qu’il ne pourra quitter qu’après d’âpres négociations avec les anglais.
Le 1er octobre, Walther atteint les objectifs assignés par l’Empereur en mettant sur pied 4 bataillons de grenadiers et 4 de chasseurs à 400 hommes, 2 régiments de grenadiers et 2 de chasseurs à cheval, 2 régiments de Dragons à 400 chevaux, 36 pièces d’artillerie et un train d’équipages portant près de 50 000 rations. Dès le 2 octobre, sur ordre de l’Empereur, Walther quitte Paris avec la moitié de la Garde pour Bayonne qu’il atteint le 30. Le général Lefebvre-Desnouettes à la tête de la seconde moitié fait mouvement le 12 octobre, le jour même où Napoléon et le Tsar Alexandre renouvellent leur alliance à l’entrevue d’Erfurt. Persuadé d’un appui du tsar, pourtant évasif sur ses intentions, l’Empereur estime qu’il peut poursuivre son engagement en Espagne sans craindre une attaque autrichienne à court terme, bien qu’elle aura lieu tôt ou tard compte tenu notamment de la pression anglaise. Ces circonstances où le bon sens commandera une anticipation amènent Napoléon à créer, le 23 octobre 1808, les « conscrits de la Garde » (qui formeront la « Jeune Garde » en 1809) à partir des classes 1806, 1807, 1808 et 1809, qui seront le socle d’une nouvelle composition des forces. Habillés à la hâte et encadrés par des soldats de la vieille Garde, ils sont répartis dans toutes les unités, les meilleurs étant affectés aux unités de fusiliers.
Le piège se referme
Le 10 octobre, la Garde impériale a déjà rejoint Bayonne. Elle s’installe au château de Marrac, alors que l’Armée est encore dispersée sur l’itinéraire entre Paris et l’Espagne. Peu importe, il y urgence, et l’Empereur prend d’emblée le commandement des troupes regroupées près de la frontière. Bien qu’en cette mi-octobre les forces espagnoles soient isolées, l’Angleterre renforce ses troupes dans la péninsule avec 33 000 hommes aux ordres du général John Moore, afin de renforcer les armées espagnoles dans leur mission d’interdire aux français l’accès à Madrid. La division du général Lasalle en tête, la Garde s’engouffre dans un pays ravagé et déserté. Au soir du 5 novembre, après avoir parcouru 170 km en 36 heures, les chasseurs à cheval rentre dans Vitoria, rejoignant les chasseurs à pied du général Lepic rongés par le désespoir comme le souligne le commandant Henry Lachouque (voir sources) : « Ils se croyaient perdus, abandonnés, dans ce pays de misère où les hommes font la guerre au couteau, les filles ensorcellent les soldats avant de les tuer et la prêtraille n’est que canaille perfide ».
Le 11 novembre, la prise de Burgos par les 50 000 hommes de Soult et par Bessières à la tête de la cavalerie de la Garde donne lieu à des atrocités devenues tragiquement familières. Les soldats isolés tombés dans des pièges parfois tendus par des petits groupes d’insurgés, voire un seul homme ou par des enfants, sont retrouvés décapités, égorgés, mutilés, enterrés vivants ou, d’après le récit de rescapés, sciés en deux après avoir été liés entre deux planches. La violence et l’horreur mènent à des représailles incontrôlées comme à l’hôpital d’Andujar, vidé par les habitants ivres de colère contre « ces païens et fils de chien ». Les nerfs sont à vifs, et on maudit cette guerre d’Espagne, cette terre ruinée, ces villages sordides et ces insurgés qui sortent de nulle part comme des fantômes, tranchent les gorges puis disparaissent sans un bruit.
Le mal être est généralisé, et on recense 43 désertions de fusiliers grenadiers en quelques jours. La Garde découvre une forme de guerre inconnue jusqu’ici et bien loin des champs de batailles de jadis : la guérilla, la guerre urbaine, la terreur et les exactions.
Objectif : Madrid
Marcher sur Madrid et s’en emparer est un objectif primordial afin que Joseph retrouve son trône. Les escarmouches sanglantes des paysans et les pertes continues sur le chemin de la capitale amènent l’Empereur à retirer les soldats de sa Garde (gendarmes d’élite et chevau-légers) de la tête du dispositif alors confiée à des chasseurs et des grenadiers à cheval. Le 30 novembre, c’est dans un épais brouillard que les troupes françaises abordent le col de Somosierra, à 90 km au nord de Madrid, dernier obstacle géographique avant la capitale. Mais l’obstacle n’est pas que géographique : les pentes sont tenues par les 9000 fantassins de Benito San Juan solidement accrochés au terrain et appuyés par des pièces d’artillerie judicieusement positionnées au bord de la piste franchissant le col. Le combat s’engage à 9 heures par un violent tir d’artillerie qui assomme l’avant-garde à la conquête du col. En fin de matinée, alors que le soleil perce la brume, le feu nourri des Espagnols interdit toute progression des fantassins cloués sur place.
Contre toute attente, Napoléon donne l’ordre à un escadron de sa propre escorte (le 3e escadron des chevau-légers polonais) de charger le verrou espagnol tenant le col. Sous un feu d’enfer, les 150 cavaliers chauffés à blanc se ruent sur les 4 batteries d’artillerie ennemies et sabrent les canonniers et les fantassins fuyant en désordre la furie des polonais. Le reste du régiment polonais du colonel Krasinski et toute la cavalerie de la Garde s’engouffrent au grand galop à travers les lignes ennemies défaites et jusqu’au village de Buytrago. Le 1er décembre, l’Empereur met à l’honneur le régiment de chevau-légers en s’écriant « Vous êtes digne de ma vieille Garde ! Honneurs aux braves des braves ! ».
Le lendemain, 2 décembre 1808, en ce jour d’anniversaire d’Austerlitz, les cris de « Vive l’Empereur ! » peinent à couvrir au loin les cloches de Madrid sonnant le tocsin, alors qu’on vide les geôles et qu’on mobilise les monastères pour aller combattre « l’Antéchrist ». Le 3 décembre, l’armée rentre en force dans Madrid qui capitule le 4. Cependant, le temps des entrées triomphales de jadis dans Vienne ou Berlin est révolu. Les rues de Madrid sont désertes, la mort rôde partout et l’angoisse des hommes entraînent des crises d’indiscipline réprimées par des exécutions en présence de 50 soldats par corps. Telle est la règle, à la fois terrible et désespérée.
A la poursuite des anglais
Apprenant l’arrivée des anglais de Sir John Moore à Valladolid (200 km nord-ouest de Madrid), Napoléon espère tenir une revanche. Il va enfin affronter sur le terrain, son éternel ennemi par une stratégie qui a fait ses preuves lors des campagnes passées : devancer l’adversaire, lui couper la route, l’isoler, le battre, le mettre en fuite et exploiter le succès dans la profondeur. La Garde est en première ligne : la cavalerie du général Lefebvre Desnouettes en soutien immédiat du corps de Ney et de la Garde à pied avec l’Empereur, autrement dit, le choc et le feu combinés. Peu importe les conditions météorologiques exécrables au col de Guadamarra, l’objectif à s’emparer (50 km au nord de Madrid), des nuits à -10°, de la boue succédant au gel : tout est une question de vitesse et de surprise. En effet, apprenant que Napoléon est à ses trousses, John Moore rebrousse chemin vers la ville maritime de la Corogne (pointe nord-ouest de l’Espagne) pour rejoindre les vaisseaux amarrés dans le port. Après 82 km parcourus en 2 jours, la Garde à pied atteint Tordesillas (province de Valladolid) et y stationne pour une courte durée, en cette nuit de Noël 1808, à la recherche d’un maigre réconfort avec des croûtons de pain noirs, de vin et d’eau de vie.
Puis, sous une pluie battante, la progression reprend vers le village de Médina de Rioseco. La manœuvre d’enveloppement des premiers éléments de l’infanterie britannique signalée au niveau du pont de Benavente (province de Valladolid) sur la rivière Elsa se met en place. Face aux assauts furieux de Lefebvre-Desnouettes et la ruée de la Garde à pied appuyée par 500 cavaliers ayant franchi l’Elsa à gué avec l’eau jusqu’à la ceinture et au bas ventre des chevaux, les anglais ripostent en attaquant de flanc les Français contraints à un repli. Blessé d’un coup de pistolet, Lefebvre-Desnouettes est fait prisonnier par les Britanniques. Alors que la cavalerie de la Garde franchit la rivière et que l’infanterie parvient à rejoindre la rive droite grâce à des moyens de fortune et au prix de malheureux emportés par le courant, les Anglais entament une retraite désordonnée après avoir pillé et brûlé le palais ducal de Benavente. Rejointe par l’Empereur, la Garde s’empare d’Astorga le jour de l’an 1809, puis rentre dans Valladolid le 6 janvier. Mais des nouvelles inquiétantes arrivent de France : Talleyrand, jouant son propre jeu en coulisse, favorise un réchauffement des relations entre Saint-Pétersbourg et Vienne qui poursuit ses préparatifs d’une entrée en guerre autrichienne. La perspective d’ouverture d’un second front (cf. section 5) amène l’Empereur à laisser ses maréchaux finir le travail et à rentrer à Paris. Soult poursuit les Anglais jusqu’à leur embarquement à la Corogne après quelques actions de combat retardateur au cours de l’un d’eux Sir John Moore est tué.
La plaie béante
Fin 1808, malgré les victoires accumulées et la prise de Madrid, l’Espagne est loin d’être soumise. Le contrôle des campagnes reste difficile et meurtrier. Les prêtres espagnols appellent leurs fidèles à la « croisade contre les Français ». L’Espagne est devenue le lieu d’une escalade inédite de formes multiples de violence et surtout d’une forme de guerre à laquelle ni l’Empereur, ni la Grande Armée, ni la Garde Impériale n’étaient préparés. … Cette nouvelle forme de guerre, c’est la guérilla, l’embuscade, le coup de main, qui déconcertent et déciment les troupes, qui transforment l’insécurité en terreur jusqu’à la panique incontrôlée, au pillage et au meurtre, aux agressions fratricides, qui détruisent le moral jusqu’à la dépression ou le suicide, qui ruinent la discipline jusqu’à la désertion, le brigandage et la rébellion ;
…Cette nouvelle forme de guerre menée par ces petits groupes de résistants invisibles, embusqués et armés de couteaux, de fourches ou de faux.
…Cette nouvelle forme de guerre effroyable et meurtrière, qui préfigure les futures conflits modernes de libération.
En proie à la famine et au désespoir, au milieu des horreurs d’une guerre impitoyable, les soldats doutent devant l’anéantissement des unités, comme l’écrit le commandant Henry Lachouque (voir sources) : « Un voile de tristesse et d’angoisse s’étend sur ces hommes, qui, pour résignés qu’ils soient de leur sort, redoutent l’avenir ». L’intervention de la France dans la péninsule ibérique évolue en guerre longue et cruelle annonciatrice d’immenses douleurs et de sacrifices dans les mois et les années à venir qui verront s’engloutir les meilleures troupes de l’Empereur. En effet, le développement de cette plaie béante et incurable au flanc de l’Empire laisse apparaître de dangereuses fissures du système impérial par le doute des troupes et le désintérêt des notables pour un régime démontrant sa vulnérabilité. Enfin et surtout, elle convainc l’Autriche que la Grande Armée n’est pas invincible. Bien que vaincue 3 fois depuis 1797, l’Autriche des Habsbourg, en ce tout début de l’an 1809, lance une nouvelle fois, un défi contre l’expansionnisme français.
Christian LE MELINER
A suivre, section 5 : « Le baptême du feu de la Jeune Garde »
« Ils grognaient et le suivaient toujours », par Auguste RAFFET (1836)
Sources : « La Garde impériale » – Commandant Henry LACHOUQUE – édition LAVAUZELLE, 1982 ;
« Le Consulat et l’Empire » – Jean-Paul BERTAUD – A. COLIN, édition 2021 ;
« Les mythes de la Grande Armée » – Sous la direction de Thierry LENTZ et Jean LOPEZ – édition PERRIN, 2022 ;
Dictionnaire d’Histoire de France – sous la direction de Alain DECAUX de l’Académie française et André CASTELOT – librairie académique Perrin, 1981 ;
Encyclopédie WIKIPEDIA.
Revue GUERRES & Histoire – n°83, mars 2025











